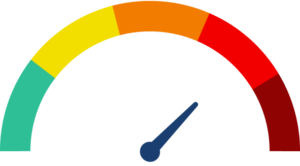Le coût d’une cyberattaque est souvent sous-estimé par les entreprises françaises. Pourtant, 47% d’entre elles ont été victimes d’au moins une attaque informatique réussie en 2024, selon le dernier baromètre du CESIN.
Derrière ce chiffre, des milliers d’entreprises se trouvent confrontées à des dépenses imprévues, des décisions à prendre dans l’urgence… avec parfois des conséquences durables sur la pérennité de leur activité. Dans ce contexte, il est essentiel de comprendre les composantes du coût d’une cyberattaque afin de protéger efficacement votre PME.

Dans cet article, vous découvrirez les coûts financiers et les conséquences extra-financières d’une cyberattaque, les raisons pour lesquelles les PME sont particulièrement ciblées par les cybercriminels ainsi que les bonnes pratiques à adopter pour limiter l’impact d’une attaque informatique sur votre entreprise.
Quel est le coût réel d’une cyberattaque pour une PME ?
1.1 Le coût d’une cyberattaque en 2025
D’après une étude réalisée par l’ANSSI, le coût moyen d’une cyberattaque s’élève à :
- 466 000 € pour les TPE et les PME.
- 13 millions d’euros pour les ETI.
- 135 millions d’euros pour les grandes entreprises.
Ce montant représente entre 5 % et 10 % du chiffre d’affaires de l’entreprise concernée, quel que soit son secteur d’activité.
Au-delà des pertes financières, l’interruption de l’activité constitue souvent le cœur du préjudice. Pendant cette période, les services sont ralentis ou à l’arrêt, les équipes mobilisées dans l’urgence, les commandes bloquées. Plus cette interruption dure, plus le coût de la cyberattaque augmente.
Plusieurs facteurs peuvent aggraver le préjudice financier comme l’absence de sauvegarde des données ou de plan de continuité d’activité. Dans ce cas de figure, l’entreprise navigue à vue et subit des pertes supplémentaires qu’elle aurait pu limiter par anticipation.
1.2 Les coûts financiers d’une cyberattaque
Une cyberattaque génère rapidement une série de dépenses visibles et immédiates :
- L’interruption des activités, qui désorganise l’entreprise sur plusieurs jours voire plusieurs semaines. Même après la résolution technique, la reprise opérationnelle est rarement immédiate. Cette situation peut entraîner l’annulation de commandes, des retards de livraison ou la perte de clients. Par exemple, un site marchand indisponible prive votre entreprise de l’un de ses canaux de vente.
- Le paiement éventuel d’une rançon. Les attaques par rançongiciels prennent vos données en otage. Les criminels exigent alors le paiement d’une rançon importante en échange de leur restitution. Cette pratique est vivement déconseillée par les autorités car elle encourage la cybercriminalité et n’offre aucune garantie quant à la restitution des données.
- La notification obligatoire à la CNIL en cas de violation de données personnelles. Il s’agit d’une obligation légale, qui vous expose à un risque d’amende si le délai de notification ou si les obligations réglementaires de protection n’ont pas été respectés par votre entreprise.
- L’enquête technique, indispensable pour comprendre l’origine de l’incident. Elle a pour but de limiter la propagation de l’attaque et d’identifier les failles exploitées. Ces prestations spécialisées sont souvent facturées à la journée et peuvent représenter plusieurs milliers d’euros.
- La restauration des systèmes informatiques et des postes de travail compromis. Celle-ci nécessite des heures d’intervention, parfois des remplacements de matériel, et exige de mobiliser des équipes techniques internes ou externes.
- Les frais juridiques, notamment en cas de mise en cause contractuelle par un client ou un fournisseur. La rédaction de courriers officiels, la constitution de dossiers de preuve ou la défense de la responsabilité de votre entreprise peuvent générer des honoraires importants.
- La communication de crise, qui implique souvent des prestataires externes pour gérer les relations presse, ou les réponses aux clients. Ce poste est essentiel pour protéger l’image de l’entreprise, mais représente un coût réel.
- La mise en conformité réglementaire, exigée par les autorités à la suite de l’attaque. Elle peut nécessiter des audits, la mise en place de nouvelles mesures de protection, ou encore la mise à jour de procédures internes.
- L’achat de solutions de cybersécurité, souvent dans l’urgence, pour combler les failles identifiées. Il peut s’agir d’antivirus professionnels, de solutions de sauvegarde, ou d’outils de détection d’intrusion, impliquant un investissement imprévu mais nécessaire.
1.3 Les coûts extra-financiers d’une cyberattaque
Au-delà des dépenses immédiates, une cyberattaque génère des impacts durables, plus difficiles à mesurer, mais souvent tout aussi coûteux :
- La perte de données critiques, comme des fichiers clients, des documents contractuels, ou irréversible et freiner durablement l’activité des informations comptables. Si votre entreprise ne dispose pas de sauvegardes ou que celles-ci ne sont pas à jour, cette perte peut être .
- Le vol de propriété intellectuelle, notamment en cas d’accès à des plans, des modèles techniques ou des développements logiciels. Ces éléments peuvent être revendus, copiés ou exploités par des concurrents, avec un impact commercial direct.
- La perte de confiance des clients et partenaires, qui peuvent douter de la fiabilité de votre organisation. Cette défiance entraîne parfois la rupture de contrats ou le non-renouvellement d’un engagement commercial.
- L’atteinte à la réputation, qui nuit à l’image de votre entreprise. Une mauvaise gestion de l’incident ou une communication mal maîtrisée peut amplifier cet effet et faire fuir prospects ou talents.
- La hausse des primes d’assurance cyber, conséquence fréquente après un incident déclaré. Certaines compagnies peuvent aussi réduire la couverture ou durcir les conditions du contrat.
- La mobilisation prolongée des équipes internes, détournées de leurs missions habituelles pour gérer la crise. Cette surcharge crée du stress, des retards dans les projets en cours. Elle peut aussi être une cause d’épuisement professionnel et provoquer du turnover.
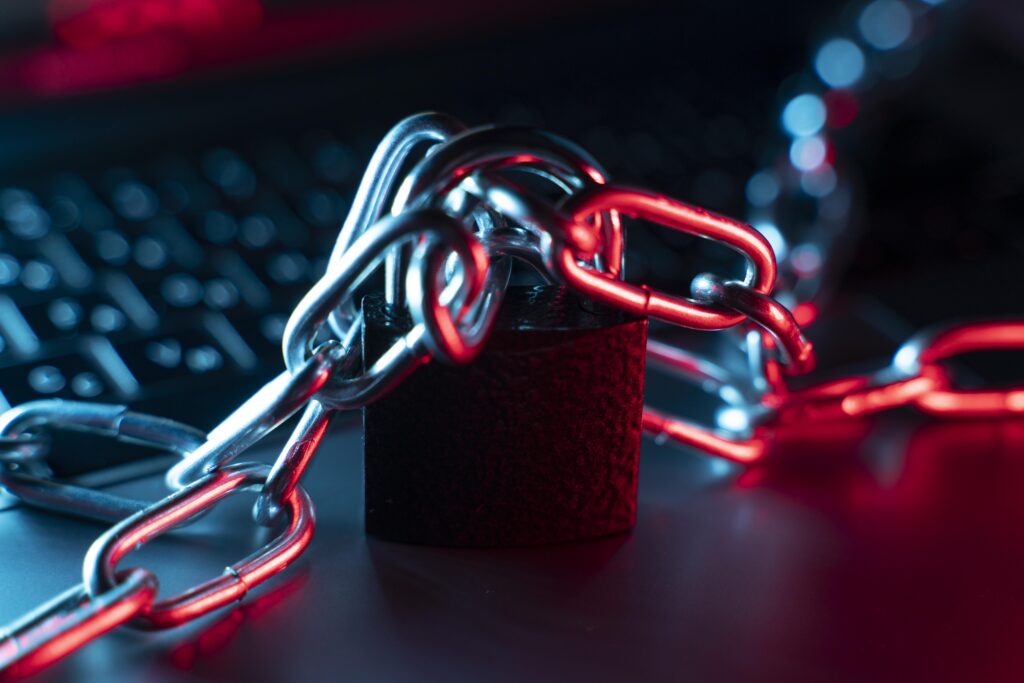
La combinaison des coûts financiers et extra-financiers fragilise la santé économique des PME. Dans les cas les plus graves, certaines entreprises ne sont pas en mesure d’absorber l’ensemble des coûts provoqués par l’attaque, au point d’être contrainte à un redressement ou à une liquidation judiciaire. De même, la responsabilité personnelle du dirigeant peut être engagée en cas de manquements importants.
Cyberattaque : pourquoi les PME sont-elles visées ?
2.1 Les PME, des cibles faciles
Contrairement aux idées reçues, les cybercriminels ne ciblent pas uniquement les grandes entreprises. En 2024, les TPE, PME et ETI représentaient 37 % des signalements reçus par l’ANSSI. La raison est simple : pour les attaquants, les PME constituent des cibles plus simples à compromettre, et donc plus rentables.
La plupart du temps, les PME ne disposent pas d’équipe de cybersécurité, ni même de prestataire externe dédié. Elles n’ont donc pas les moyens d’assurer une veille continue ou de réagir rapidement en cas d’incident. Par ailleurs, certaines attaques comme les campagnes de phishing ou l’exploitation de failles non corrigées sont largement automatisées. Les criminels utilisent des outils capables de scanner des millions de sites ou d’adresses IP en quelques minutes. Les entreprises vulnérables sont détectées sans ciblage spécifique : elles sont simplement « trouvées ».
Ce modèle de cybercriminalité repose sur la rentabilité du volume. Une attaque réussie sur une PME peut rapporter quelques dizaines de milliers d’euros pour un effort technique minimal. À l’échelle mondiale, ces campagnes massives génèrent des gains considérables pour les attaquants, qui privilégient donc les cibles faciles plutôt que les systèmes les mieux protégés.
2.2 Une exposition souvent méconnue
La plupart des dirigeants n’ont pas une idée précise de leur surface d’attaque. Par exemple, ils ne savent pas exactement ce que leur entreprise rend accessible sur Internet. Ce manque de visibilité est fréquent dans les PME, qui ne disposent ni d’outils de supervision adaptés, ni de ressources internes pour suivre ces expositions dans le temps.
Or, cette méconnaissance crée un terrain favorable aux attaques. Ces services laissés accessibles et ces outils mal sécurisés peuvent être détectés par les attaquants et utilisés comme une porte d’entrée pour mener une attaque.

Comment limiter le coût d’une cyberattaque pour votre entreprise ?
3.1 Adopter les bons réflexes au quotidien
Pas besoin d’être un expert en cybersécurité pour renforcer le niveau de protection de votre entreprise. Vous pouvez dès aujourd’hui prendre une série de mesures, simples à mettre en œuvre, pour réduire les risques et limiter sensiblement le coût d’une cyberattaque.
- Mettez à jour tous vos logiciels, même les plus secondaires. Ces mises à jour comportent des correctifs de sécurité qui comblent les failles connues utilisées par les attaquants pour s’introduire dans un système.
- Désactivez les services ou les outils en ligne que vous n’utilisez plus. Chaque service inutile exposé augmente votre surface d’attaque sans apporter de valeur.
- Activez l’authentification multi-facteurs (MFA) sur vos comptes de messagerie, vos outils métier et vos interfaces d’administration. C’est une protection simple et efficace contre les tentatives de connexion non autorisées.
- Sauvegardez régulièrement vos données, sur des supports externalisés et hors ligne, reste l’un des leviers les plus efficaces. Une sauvegarde exploitable peut permettre de restaurer rapidement votre activité.
- Vérifiez la couverture réelle de votre assurance cyber, si vous en avez une. Toutes les polices ne couvrent pas les mêmes incidents ni les mêmes montants. Relisez les exclusions, les franchises et les conditions de déclenchement avant qu’un sinistre ne survienne. Si vous n’avez pas d’assurance cyber, en adopter une vous offrira des garanties pour une meilleure maîtrise des coûts en cas de cyberattaque.
3.2 Miser sur des actions à fort impact
Certaines mesures demandent un peu plus d’investissement, mais elles permettent de réduire significativement votre exposition et les coûts en cas d’attaque.
- Réalisez un diagnostic de votre niveau d’exposition. Il existe des outils automatisés, comme celui proposé par Sekost, qui permettent d’obtenir une cartographie claire de ce que votre entreprise rend accessible en ligne. Ce type d’évaluation aide à repérer les failles visibles, sans mobiliser de ressources techniques internes.
- Organisez une formation de vos collaborateurs aux principales cybermenaces. Une session courte, ciblée et régulière, prodiguée par un expert en cybersécurité peut suffire à ancrer de bons réflexes… et éviter à vos équipes de commettre des erreurs pouvant affecter la sécurité de votre entreprise.
- Établissez un plan de continuité d’activité (PCA) afin de définir la marche à suivre en cas d’attaque. Ce document doit préciser qui fait quoi en cas d’incident, comment rétablir les opérations au plus vite et comment informer les clients ou partenaires. Il vous permet de réagir au mieux en situation d’urgence pour endiguer rapidement l’attaque et minimiser le préjudice financier.
- Entamez un travail de conformité avec les réglementations en vigueur, à l’instar du RGPD qui spécifie notamment des mesures de sécurité appropriées pour en garantir la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité. En plus de réduire le niveau d’exposition, cela réduit également le risque de sanction en cas d’attaque.
Conclusion
Le coût d’une cyberattaque ne se limite pas à quelques heures d’activité interrompue. Les conséquences s’étendent souvent pendant plusieurs mois, fragilisent la trésorerie, dégradent l’image de marque et la relation client.
Les PME ne sont pas des cibles par erreur : elles le deviennent parce qu’elles sont visibles, accessibles et souvent peu préparées. Pourtant, les moyens de réduire l’exposition au risque et d’en limiter les impacts existent.
Privilégiez des leviers accessibles et à fort impact pour renforcer la capacité de votre entreprise à résister aux menaces informatiques et diminuer le coût de la cyberattaque lorsque celle-ci surviendra.