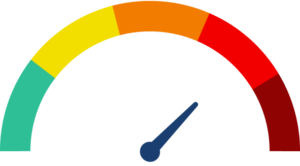Les cyberattaques n’épargnent plus personne. Petites structures, collectivités, professions libérales ou sous-traitants techniques, toutes les organisations sont devenues des cibles potentielles. En France, selon le rapport Hiscox Cyber Readiness 2024, plus d’une entreprise sur deux a déclaré avoir subi au moins une cyberattaque au cours des 12 derniers mois. Les PME y sont de plus en plus exposées, souvent sans disposer des ressources pour s’en défendre efficacement.
Face à cette réalité, il ne suffit plus de réagir après coup : il faut anticiper. Et pour cela, encore faut-il comprendre ce à quoi l’on est exposé.

Classer les attaques informatiques par catégories permet de mieux appréhender la diversité des menaces, d’identifier les plus critiques selon votre activité, et d’ajuster votre stratégie de protection en conséquence. Cette démarche est d’autant plus utile pour les dirigeants non spécialistes, qui doivent prendre des décisions rapides, souvent sans service informatique interne.
Dans cet article, vous allez découvrir les grandes familles d’attaques informatiques, les mécanismes qui les sous-tendent, comment les reconnaître dans un contexte réel, et surtout comment agir concrètement pour vous en prémunir, même sans expertise technique.
1. Qu’est-ce qu’une attaque informatique ? Définition et principes de base
Avant de parler de catégories, il est essentiel de définir ce qu’est concrètement une attaque informatique. Cela permet de mieux cerner ce que recouvrent les menaces et d’éviter les confusions fréquentes avec d’autres notions proches.
1.1 Définition d’une attaque informatique
Selon l’ANSSI (Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information), une attaque informatique désigne « toute action malveillante visant à altérer le fonctionnement normal d’un système d’information, ou à porter atteinte à la confidentialité, l’intégrité ou la disponibilité des données qu’il traite ». Cette définition est partagée par le NIST américain, qui précise qu’il s’agit de « toute tentative réussie ou non de perturber, détruire ou obtenir un accès non autorisé à un système numérique ou à ses données ».
Autrement dit, il ne s’agit pas seulement d’un piratage spectaculaire ou d’un virus : une attaque peut être silencieuse, ponctuelle ou continue, automatisée ou ciblée, avec des conséquences variables selon les cas.
1.2 Le triptyque CID : confidentialité, intégrité, disponibilité
Toute attaque vise, directement ou indirectement, à compromettre un ou plusieurs des trois piliers de la cybersécurité :
- Confidentialité : accéder à des informations qui ne devraient pas l’être (ex. : données clients, contrats, emails internes)
- Intégrité : modifier ou corrompre des données ou systèmes sans autorisation (ex. : fausse facture, manipulation d’un fichier source)
- Disponibilité : rendre un service inaccessible ou inutilisable (ex. : attaque DDoS sur un site de commande)
Ce modèle CID (ou CIA en anglais pour Confidentiality – Integrity – Availability) est une grille de lecture indispensable pour évaluer l’impact potentiel d’une attaque sur votre activité.
1.3 Attaque, vulnérabilité, menace : ne pas confondre
Ces trois termes sont souvent utilisés de manière interchangeable, à tort. Voici comment les distinguer :
| Terme | Définition |
| Menace | Une intention ou possibilité d’attaque (ex. : un groupe cybercriminel actif) |
| Vulnérabilité | Une faille exploitable dans un système (ex. : mot de passe par défaut) |
| Attaque | L’action d’exploiter une vulnérabilité dans un but malveillant |
2. Quelles sont les grandes catégories d’attaques informatiques ?
Toutes les cyberattaques ne se ressemblent pas. Pour s’en prémunir efficacement, il est essentiel de comprendre leurs différentes formes. On distingue généralement quatre grandes catégories d’attaques, en fonction de la manière dont les systèmes ou les utilisateurs sont ciblés. Chacune présente des risques spécifiques, que votre entreprise doit apprendre à reconnaître.

2.1 Attaques logicielles (ou techniques)
Ces attaques exploitent directement les failles présentes dans les logiciels, systèmes d’exploitation ou applications utilisées au sein de l’entreprise. Il peut s’agir de programmes malveillants (malwares), de virus, de vers informatiques, ou encore de ransomwares qui chiffrent vos données contre rançon.
Par exemple, un cabinet d’architecture victime d’un ransomware peut voir l’ensemble de ses plans et documents chiffrés, rendant impossible toute activité tant qu’un paiement n’est pas effectué (souvent en cryptomonnaie).
Les moyens de prévention sont bien connus, mais encore trop souvent négligés : mise à jour régulière des systèmes, suppression des logiciels obsolètes, contrôle des accès, et surtout, analyse de vulnérabilités pour repérer les failles avant qu’elles ne soient exploitées. Certaines plateformes, comme Sekost, permettent de réaliser ce type de diagnostic automatiquement à partir d’un simple nom de domaine, sans configuration complexe.
2.2 Attaques réseau
Ces attaques visent les infrastructures de communication de l’entreprise. Parmi les plus fréquentes, on retrouve par exemple les attaques par déni de service (DDoS) ou les attaques de type man-in-the-middle (interception de communications).
Un exemple concret : un site e-commerce ciblé par une attaque DDoS pendant une période de forte activité (soldes, Noël) peut devenir inaccessible pendant plusieurs heures, entraînant une perte de chiffre d’affaires directe.
Ce type d’attaque correspond à ce que les moteurs de recherche qualifient parfois de « boycott de site web ». Les outils de détection et de protection réseau (firewall applicatif, pare-feu, services de mitigation) sont essentiels pour y faire face.
2.3 Attaques par ingénierie sociale
L’ingénierie sociale repose sur la manipulation humaine. Ici, l’attaquant ne s’en prend pas aux systèmes, mais aux utilisateurs, en les incitant à faire eux-mêmes des erreurs : cliquer sur un lien piégé, fournir des identifiants, ou valider un virement frauduleux.
Les techniques les plus connues sont le phishing (email trompeur), le spear phishing (ciblage personnalisé), le vishing (arnaque téléphonique), ou encore l’usurpation d’identité.
Dans les PME, ces attaques sont particulièrement redoutables : fausses factures, piratage de boîte mail d’un dirigeant, demandes urgentes de paiement… Tous les signaux d’alerte passent souvent inaperçus. La technique seule ne suffit pas : la sensibilisation des équipes est ici la première ligne de défense.
2.4 Attaques physiques et compromissions internes
Ces attaques passent souvent sous les radars, mais elles sont tout aussi dangereuses. Il peut s’agir d’un vol de matériel (ordinateur portable, disque dur), d’un accès non autorisé aux locaux ou à un poste connecté, ou encore d’une clé USB infectée introduite dans un système.
Les compromissions internes représentent une autre menace : un collaborateur mécontent, un prestataire malveillant, ou tout simplement un utilisateur négligent peut exposer involontairement des données sensibles.
Dans les petites structures, où les équipements sont parfois partagés et les contrôles d’accès légers, ces risques doivent être pris au sérieux. Des règles simples (verrouillage de session, chiffrement des supports, journalisation des accès) peuvent limiter considérablement les conséquences d’un incident.
3. Quelles sont les formes de piratage les plus fréquentes en 2025 ?
Les attaques informatiques prennent des formes variées, mais certaines reviennent systématiquement. Comprendre les grands types de piratage permet de mieux identifier les scénarios auxquels votre entreprise peut être confrontée. En 2025, plusieurs tendances se confirment, touchant de plus en plus les structures de taille moyenne.

3.1 Les 4 formes de piratage les plus répandues
On peut regrouper la majorité des attaques en quatre grandes formes, chacune correspondant à un mode opératoire et un objectif différent :
- Intrusion : il s’agit d’un accès non autorisé à un système. L’attaquant exploite une faille de sécurité (comme un logiciel non à jour ou un mot de passe faible) pour s’introduire dans votre réseau ou vos applications. Cette étape est souvent le point de départ d’attaques plus complexes.
- Espionnage : une fois à l’intérieur, l’attaquant peut collecter des données confidentielles : bases clients, contrats, échanges internes, brevets, etc. Il peut s’agir de cybercriminels à but lucratif, mais aussi de concurrents ou d’acteurs étatiques dans des secteurs stratégiques.
- Sabotage : l’objectif est ici de nuire. Cela peut passer par la suppression de données, la neutralisation d’un service ou la modification d’informations critiques (ex. : corruption d’un catalogue produit ou d’un fichier comptable).
- Extorsion : cette forme de piratage est aujourd’hui la plus médiatisée. Le cas typique est celui d’un ransomware, où vos fichiers sont chiffrés et rendus inutilisables jusqu’au paiement d’une rançon. Mais d’autres formes existent : chantage à la divulgation de données, menaces de perturbation en ligne, etc.
Ces catégories ne sont pas exclusives : une attaque peut combiner plusieurs objectifs (ex. : intrusion suivie d’espionnage et d’extorsion).
3.2 Zoom sur les cybercriminels : quels profils ?
Toutes les attaques ne viennent pas des mêmes profils. Mieux comprendre qui sont les attaquants aide à mieux cerner leurs intentions, leurs méthodes, et leur niveau de sophistication.
Voici les profils les plus fréquemment rencontrés :
- Black hat : ce sont les pirates “classiques”, motivés par l’argent. Ils utilisent des outils automatisés pour cibler des failles connues, souvent sans viser une entreprise en particulier.
- Hacktivistes : ils agissent pour des raisons idéologiques, politiques ou militantes. Leurs actions visent à perturber ou dénoncer, plutôt qu’à obtenir un gain financier.
- Script kiddies : ce sont des attaquants peu expérimentés qui utilisent des outils existants sans bien comprendre leur fonctionnement. Ils peuvent causer des dégâts par maladresse autant que par malveillance.
- Insiders : collaborateurs, prestataires, sous-traitants… Par négligence ou malveillance, ils peuvent devenir une menace interne difficile à détecter, car ils bénéficient souvent d’un accès légitime aux systèmes.
Évaluer le type d’attaquant le plus probable selon votre activité (et vos données) permet de mieux prioriser les protections à mettre en place.
3.3 Panorama actuel des menaces
Les tendances récentes confirment une intensification des attaques ciblant les PME, notamment dans les secteurs professionnels, industriels et de services. Selon le rapport annuel de l’ENISA (European Union Agency for Cybersecurity), les menaces les plus observées en 2024 comprennent :
- Les ransomwares, toujours en tête, avec des modes de diffusion plus sophistiqués
- Le phishing ciblé, devenu plus difficile à détecter
- L’exploitation automatisée de vulnérabilités non corrigées
- Les attaques sur les chaînes de fournisseurs, y compris via des prestataires IT
Pour de nombreuses entreprises, il est difficile de savoir si elles sont exposées ou non. C’est pourquoi un audit régulier, même allégé, est devenu une pratique essentielle. Il peut s’agir d’un audit interne structuré, d’une mission ponctuelle menée par un tiers, ou d’un test à distance comme ceux proposés par Sekost, basé sur l’analyse de la surface d’exposition visible depuis internet. Ce type de diagnostic rapide permet de prendre conscience des failles les plus évidentes avant qu’elles ne soient exploitées.
4. Comment reconnaître et se prémunir des principales menaces ?
Reconnaître les menaces, c’est d’abord accepter qu’elles ne prennent pas toujours une forme évidente. Elles ne viennent pas exclusivement de l’extérieur, ni toujours sous la forme d’un virus ou d’un ransomware. Certaines menaces sont invisibles, internes, ou liées à des éléments que l’on croit sous contrôle. Pour construire une défense efficace, il est utile de s’appuyer sur une typologie claire.
4.1 Les 4 classes de menaces
Toutes les menaces informatiques ne prennent pas la forme d’une attaque volontaire. Pour structurer votre stratégie de protection, il est utile de distinguer quatre grandes catégories de risques susceptibles de compromettre vos systèmes ou vos données :
- Intentions malveillantes : ce sont les menaces les plus visibles. Elles proviennent d’individus ou de groupes (cybercriminels, hacktivistes, attaquants isolés) qui cherchent à accéder à vos données, perturber vos services ou obtenir une rançon. Ils exploitent des failles techniques ou humaines pour atteindre leur objectif.
- Erreurs humaines : il peut s’agir d’un mot de passe trop simple, d’un email envoyé au mauvais destinataire, d’un lien de phishing ouvert par inadvertance ou d’un mauvais paramétrage de sécurité. Ces erreurs sont responsables d’une grande partie des incidents de cybersécurité.
- Défaillances techniques : infrastructures vieillissantes, systèmes non mis à jour, logiciels non maintenus, configurations hasardeuses… Ces vulnérabilités créent des portes d’entrée involontaires pour les attaquants, ou provoquent des interruptions de service critiques.
- Incidents opérationnels non intentionnels : coupure de réseau, panne de serveur, défaillance d’un prestataire cloud, rupture d’un service essentiel, voire conséquences numériques d’une crise externe (ex. : indisponibilité de services publics, tensions géopolitiques impactant les DNS). Ces situations ne sont pas des attaques, mais peuvent provoquer des effets similaires en termes d’indisponibilité ou de perte de données.
Ces quatre classes ne sont pas exclusives : dans de nombreux cas, un incident résulte d’une combinaison de causes, comme une faille technique exploitée par un acteur malveillant, ou une erreur humaine amplifiée par l’absence de plan de reprise. Comprendre cette typologie vous aide à renforcer vos défenses sans vous limiter aux seuls scénarios de cyberattaque.
4.2 Bonnes pratiques essentielles
Aucune entreprise n’est à l’abri à 100 %, mais certaines mesures simples permettent de réduire considérablement le niveau de vulnérabilité :
- Mettre en place une authentification forte (mot de passe complexe + double facteur)
- Mettre à jour régulièrement les logiciels et équipements (correctifs de sécurité)
- Réaliser des sauvegardes fréquentes, idéalement sur un support non connecté au réseau
- Segmenter le réseau pour limiter la propagation en cas d’intrusion
- Limiter les privilèges d’accès aux données sensibles
La première étape concrète reste souvent le diagnostic initial. Il peut être simple, rapide et non intrusif. Des outils comme Sekost permettent par exemple d’analyser automatiquement votre exposition à partir d’un nom de domaine public. Ce type d’analyse identifie les failles visibles depuis internet, en quelques minutes, et fournit un rapport lisible, même sans expertise technique.
4.3 Les erreurs fréquentes à éviter
Certaines idées reçues entretiennent une fausse impression de sécurité, en particulier dans les petites structures. Voici les erreurs les plus courantes à éviter :
- Penser que « ça n’arrive qu’aux grandes entreprises » : en réalité, les PME sont souvent plus ciblées car moins bien protégées.
- Traiter toutes les failles au même niveau : un mot de passe faible exposé sur internet est bien plus critique qu’un correctif manquant sur une machine isolée. La priorisation par risque est essentielle.
- Sous-estimer le facteur humain : 9 attaques sur 10 impliquent une action humaine, volontaire ou non. La sensibilisation du personnel est aussi importante que la technologie.
Une politique de sécurité efficace ne repose pas uniquement sur les outils, mais sur la capacité à anticiper, hiérarchiser et corriger intelligemment.
Conclusion : Savoir classer les attaques pour mieux protéger votre entreprise
Quand on ne sait pas par où commencer en cybersécurité, tout semble flou, urgent ou trop technique. Classer les attaques change la donne. Cela vous permet de structurer votre réflexion : quelles sont les menaces réelles pour mon entreprise, comment agissent-elles, que puis-je mettre en place rapidement pour y répondre.
En tant que dirigeant, vous n’avez pas besoin de maîtriser les détails techniques. Mais vous gagnez à identifier les types d’attaques les plus probables selon votre activité, à éviter les erreurs fréquentes (comme sous-estimer le facteur humain), et à prioriser les actions simples à fort impact : gestion des accès, mises à jour, sensibilisation, sauvegardes.
Ce cadrage vous aide à sortir de l’immobilisme, à dialoguer avec vos prestataires en posant les bonnes questions, et à lancer une démarche efficace, même sans service cyber dédié. Ce n’est pas une course à la perfection, mais une montée en maturité progressive, à partir d’une meilleure compréhension des risques.