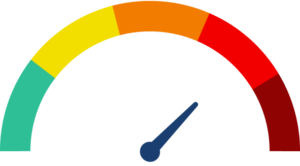Votre site web est-il vraiment sécurisé ? Pour de nombreuses PME, cette question ne devient concrète qu’après un incident. Pourtant, une simple faille sur une application en ligne peut suffire à exposer des données sensibles, perturber votre activité ou porter atteinte à votre réputation.

Aujourd’hui, votre site vitrine, votre portail client ou vos services web sont autant de portes d’entrée potentielles pour un attaquant. Mots de passe faibles, mises à jour oubliées, failles de logique métier… Ces erreurs, courantes et invisibles pour l’utilisateur, peuvent avoir des conséquences lourdes. C’est précisément ce que permet d’évaluer un pentest web (ou test d’intrusion d’application web) : en simulant une attaque dans un cadre sécurisé, il révèle les failles exploitables et permet de les corriger avant qu’un acteur malveillant ne les découvre.
Dans cet article, vous allez comprendre ce qu’est un pentest web, à quoi il sert, quelles sont les méthodes utilisées, pourquoi il est pertinent y compris pour une PME, et comment s’y préparer efficacement même sans équipe cybersécurité dédiée.
Objectif : vous donner une vision claire et actionnable de cet outil, afin de décider s’il est temps pour votre entreprise de passer à l’action.
1. Qu’est-ce qu’un pentest web et à quoi sert-il ?
1.1 Une définition rigoureuse pour comprendre l’approche
Un pentest web, ou test d’intrusion, est une simulation contrôlée d’attaque informatique visant à évaluer la résistance d’un site ou d’une application web face à un attaquant réel. Il s’agit de “simuler une attaque contre un système pour identifier et exploiter ses vulnérabilités” dans un cadre légal et sécurisé (source NIST).
Ce test va bien au-delà d’un simple contrôle automatisé. Contrairement à :
- un audit de sécurité, qui évalue les procédures, les configurations ou la conformité à une norme (par exemple ISO 27001) ;
- un scanner de vulnérabilités, qui détecte automatiquement des failles connues sans démonstration d’impact.
Le pentest, lui, reproduit le raisonnement d’un attaquant. Il met à l’épreuve votre application en identifiant les faiblesses techniques ou logiques réellement exploitables, et en évaluant leur impact concret sur vos données ou votre activité.
Le pentest web s’applique aux services accessibles depuis Internet (site vitrine, portail client, e-commerce, API), et se distingue ainsi :
- du pentest réseau, qui cible les équipements internes ou l’architecture système ;
- du pentest mobile, dédié aux applications Android ou iOS.
1.2 Identifier les failles critiques avant qu’un attaquant ne le fasse
L’intérêt principal d’un pentest web est de repérer les vulnérabilités qui ouvriraient la porte à une attaque : injection SQL, faille XSS (Cross-Site Scripting), défaut de gestion d’authentification, accès non autorisé à des données sensibles ou encore faille de logique métier (par exemple, modifier le montant d’une commande côté client).
Au-delà de la détection, un pentest mesure l’impact réel de ces failles : que peut obtenir un pirate s’il exploite cette vulnérabilité ? Peut-il accéder à la base de données clients, contourner les droits d’accès, perturber le service ?
Chaque test aboutit à un rapport structuré contenant :
- des preuves concrètes d’exploitation,
- une évaluation des risques,
- des recommandations correctives.
Pour une entreprise, ce rapport est une feuille de route priorisée pour améliorer sa sécurité. Il est aussi un levier de conformité, notamment vis-à-vis de la directive NIS2, qui impose une gestion active des risques numériques aux entités concernées.
Un pentest web permet de passer d’une perception théorique des risques à une évaluation factuelle et exploitable, dans une logique de prévention, de transparence et de résilience.
2. Quels sont les principaux types de pentest ?
2.1 Trois approches selon le niveau d’information fourni
Un pentest peut être réalisé de différentes façons, en fonction du niveau d’information auquel l’attaquant simulé a accès au départ. Ces approches permettent d’adapter le test à des scénarios réalistes, en reproduisant plusieurs profils de menaces.
- Pentest en boîte noire : le testeur n’a aucune information préalable. Il se comporte comme un attaquant qui découvre une application pour la première fois. Ce scénario met l’accent sur la surface d’attaque publique (ex : site web, formulaire de contact, interface de connexion). Ce type de test permet souvent de révéler des erreurs de configuration ou des failles accessibles sans authentification.
- Pentest en boîte grise : le testeur dispose de certains accès (par exemple, un compte utilisateur) ou d’informations partielles sur l’architecture du système. Ce scénario reflète une situation fréquente : un attaquant a compromis un compte ou a acquis des informations internes (fuite, phishing, etc.). Il permet de tester la capacité de l’application à cloisonner les droits ou à détecter des tentatives d’élévation de privilège.
- Pentest en boîte blanche : le testeur a un accès complet aux informations techniques (code source, documentation, architecture) et parfois aux comptes administrateur. Ce test est plus approfondi : il permet d’auditer la sécurité en profondeur, d’examiner les mécanismes internes et de vérifier la conformité aux bonnes pratiques de développement sécurisé. Il est souvent utilisé dans une logique de validation (ex : avant une mise en production).
Chaque approche a sa valeur selon les objectifs fixés. Dans la pratique, un bon test combine souvent plusieurs niveaux pour refléter les risques réels et les angles d’attaque possibles.
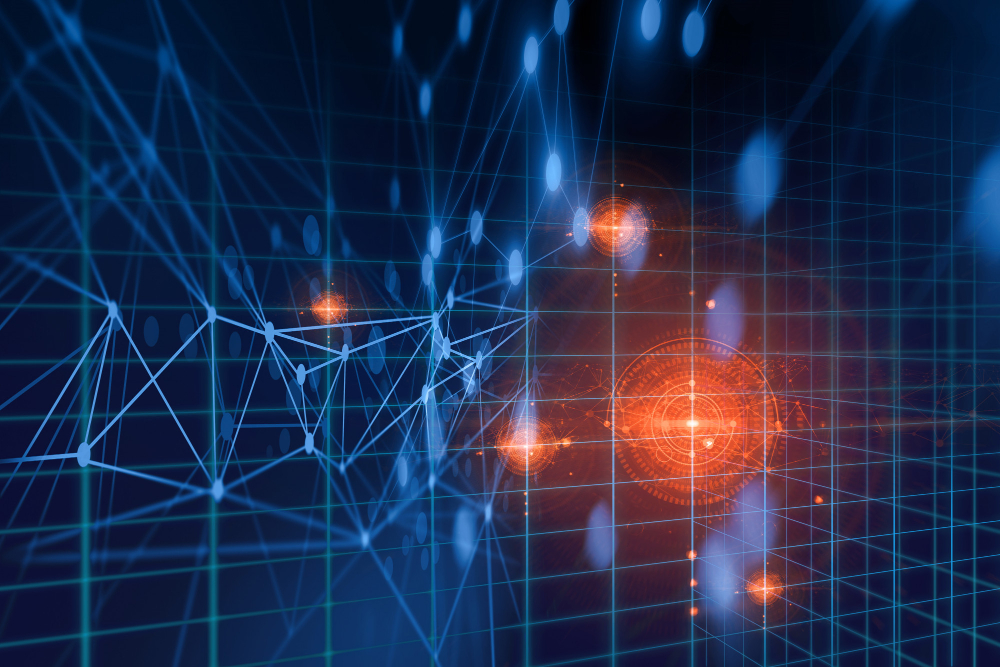
2.2 Pentest externe ou interne : deux angles complémentaires
Un autre critère de distinction important concerne le point d’entrée simulé :
- Le pentest externe évalue les systèmes exposés publiquement sur Internet. Il vise à identifier les vulnérabilités accessibles à un attaquant situé à l’extérieur de l’entreprise. Cela inclut les sites web, APIs, serveurs web, sous-domaines, services DNS ou messagerie. C’est souvent le premier test recommandé, car il cible les actifs les plus exposés et donc les plus à risque.
- Le pentest interne simule une attaque lancée depuis l’intérieur du réseau (ex : un salarié malveillant, un prestataire compromis, ou un attaquant ayant déjà franchi une première barrière). Il permet d’évaluer la résilience des systèmes internes. Ce test est particulièrement utile dans un contexte de sensibilisation ou de validation de politiques de sécurité internes.
Que vous cherchiez à évaluer votre exposition externe ou à vous protéger d’un risque interne, choisir le bon type de pentest web permet de prioriser vos efforts et de détecter les failles là où elles comptent le plus.
3. Comment se déroule un pentest web ?
Un pentest web suit une méthodologie rigoureuse, souvent fondée sur des standards reconnus comme le PTES (Penetration Testing Execution Standard). L’objectif est de reproduire les différentes étapes qu’un attaquant suivrait pour compromettre un système, mais dans un cadre maîtrisé, documenté et sans impact pour l’entreprise.
3.1 Les 7 étapes typiques d’un pentest web
- Définition du périmètre et des objectifs
Quelles applications ou adresses IP sont testées ? Quelles sont les contraintes (techniques, juridiques, horaires) ? Le prestataire et l’entreprise s’accordent sur les cibles, les limites à ne pas franchir, et les résultats attendus (exemple : démontrer l’accès à des données sensibles, tester la résistance à une élévation de privilège, etc.).
- Collecte d’informations (reconnaissance)
Le pentesteur collecte un maximum d’informations accessibles publiquement : détection de sous-domaines, analyse de services exposés, récupération d’empreintes technologiques (CMS utilisé, serveur, version logicielle), voire recherche d’informations sur les employés (noms d’utilisateurs, mots de passe divulgués sur le web).
- Recherche de vulnérabilités
À partir des informations collectées, le pentesteur utilise des outils automatisés et des méthodes manuelles pour repérer les failles connues. Il cherche, par exemple, des composants obsolètes, des formulaires non sécurisés, ou des fichiers exposés. Cette phase permet de dresser une cartographie initiale des vulnérabilités potentielles, qui seront ensuite testées concrètement.
- Exploitation des failles
C’est le cœur du test. Le prestataire tente d’exploiter les failles identifiées pour en mesurer l’impact : vol de données, contournement d’authentification, exécution de code à distance, etc. Cette étape distingue le pentest d’un simple scan. Elle permet de prouver qu’une vulnérabilité n’est pas seulement théorique, mais exploitable dans un contexte réel.
- Post-exploitation (maintien d’accès, escalade de privilèges)
Si l’exploitation réussit, le testeur simule les actions d’un attaquant après intrusion. Peut-il rester dans le système sans être détecté ? Accéder à d’autres services ? Obtenir des droits administrateur ? Cette étape permet d’évaluer la résilience de l’environnement et la capacité de l’entreprise à détecter des comportements anormaux.
- Rapport détaillé et présentation des résultats
Une fois les tests terminés, le prestataire rédige un rapport clair et structuré. Il présente :
- les vulnérabilités découvertes, avec leur niveau de criticité (exemple : échelle CVSS),
- les preuves d’exploitation (captures d’écran, requêtes utilisées),
- les recommandations concrètes de remédiation.
Le rapport est souvent accompagné d’une restitution orale, adaptée aux profils techniques et non techniques. C’est un moment d’échange important pour comprendre les risques et prioriser les actions.
- Accompagnement à la remédiation et re-tests
Un bon pentest ne s’arrête pas au rapport. Il prévoit un accompagnement dans la mise en œuvre des correctifs. Un retest peut être réalisé pour vérifier que les vulnérabilités ont bien été corrigées. Certains outils comme Sekost facilitent cette phase en automatisant le suivi dans le temps.
3.2 Outils et référentiels utilisés pendant le pentest
Les pentesters s’appuient sur une combinaison d’outils spécialisés et de référentiels de sécurité reconnus. Parmi les plus utilisés :
- Nmap : pour détecter les ports ouverts et les services en ligne.
- Burp Suite : pour analyser, modifier et rejouer les requêtes web.
- SQLMap : pour tester les injections SQL sur les formulaires ou paramètres.
- Scripts personnalisés : adaptés aux spécificités de l’application testée.
Côté référentiels, les tests sont généralement structurés autour de :
- PTES pour la méthodologie,
- OWASP Top 10, qui recense les failles web les plus critiques (injection, XSS, mauvaise gestion des sessions, etc.),
- CVE (Common Vulnerabilities and Exposures), qui regroupe les failles connues publiquement,
- PASSI ANSSI, pour les prestataires qualifiés en France.
En combinant ces outils et référentiels, les prestataires peuvent adapter chaque test à la réalité de l’entreprise, tout en garantissant une couverture complète des vecteurs d’attaque pertinents. Le résultat : un audit réaliste, reproductible, et exploitable par les équipes internes ou vos prestataires IT.
4. Pourquoi réaliser un pentest web, même pour une PME ?
4.1 Un site vulnérable, c’est une porte d’entrée
Dans de nombreuses PME, le site web ou le portail client est devenu un point névralgique de l’activité : il héberge des données sensibles, permet des transactions ou donne accès à des espaces réservés. Mais si ce point d’entrée est mal sécurisé, il peut se transformer en porte ouverte pour un attaquant.
Les exemples sont nombreux : une injection SQL mal corrigée peut permettre d’extraire toute une base de données clients, un XSS non détecté peut être utilisé pour détourner des sessions ou installer un malware, un back-office exposé peut être pris en main à distance faute de configuration correcte. Un seul point faible suffit souvent à provoquer une fuite de données, une paralysie de l’activité ou un incident de réputation difficile à maîtriser.
Les attaques opportunistes (robots, scans automatisés, campagnes de phishing) visent toutes les organisations, pas seulement les grands groupes. Et les PME sont souvent les plus vulnérables faute de protections avancées ou de veille technique.
4.2 Un levier de prévention, de conformité et de confiance
Réaliser un pentest web est avant tout une démarche proactive de gestion des risques. Cela permet d’anticiper les failles, et d’organiser une réponse appropriée avec vos équipes ou prestataires. En ce sens, le pentest s’intègre pleinement dans une stratégie de cybersécurité adaptée aux PME, en complément des bonnes pratiques de base (mises à jour, sauvegardes, gestion des accès…).
C’est aussi un outil de conformité : de nombreuses réglementations, comme le RGPD ou la directive NIS2, incitent les entreprises à vérifier régulièrement la sécurité de leurs systèmes exposés. Un pentest documenté, assorti d’un plan de remédiation, est une preuve concrète de diligence que vous pouvez produire en cas de contrôle ou d’incident.
Enfin, c’est un signal fort de confiance pour vos partenaires et clients. Montrer que vous avez audité votre sécurité, corrigé les failles critiques et documenté votre démarche, c’est valoriser votre sérieux.
Pour les PME qui ne savent pas par où commencer, des outils accessibles comme Sekost permettent d’initier une évaluation automatisée de la surface d’attaque, simplement à partir du nom de domaine. Ce type de diagnostic permet de détecter les failles les plus visibles avant d’aller plus loin avec un test approfondi. C’est une première étape concrète, rapide et compréhensible pour structurer une démarche progressive.

5. Comment se préparer à un pentest web ?
Un pentest web bien mené repose autant sur la phase de préparation que sur la phase de test elle-même. Même sans expert en cybersécurité dédié, une PME peut structurer cette démarche de façon simple et efficace.
5.1 Les prérequis essentiels
Avant de lancer le test, il est important d’identifier les actifs critiques : site vitrine, espace client, API, extranet, etc. Un audit préalable ou un diagnostic automatisé, comme ceux proposés par Sekost, peut aider à clarifier le périmètre à tester.
Il faut aussi choisir le bon moment. Évitez les périodes commerciales clés ou les déploiements majeurs pour ne pas perturber l’activité. Enfin, définissez des objectifs clairs : s’agit-il de simuler un vol de données, un accès non autorisé, une prise de contrôle ? Ce cadrage oriente les actions du testeur.
5.2 Impliquer les bonnes parties prenantes
Un pentest implique plusieurs acteurs. La direction qui doit valider la démarche. Le prestataire web ou l’hébergeur qui doivent être informés (surtout si le test a lieu en production). Si vous avez un référent technique, il facilitera les échanges avec le pentesteur. Sinon, prévoyez un contact opérationnel disponible pour répondre aux demandes ou coordonner les accès.
Selon les cas, le test peut se faire en production (sous surveillance) ou sur un environnement dédié reproduisant les conditions réelles.
5.3 Que faire après le test ?
Une fois le rapport reçu, la priorité sera de corriger les failles critiques en priorité. Un bon prestataire vous proposera un plan de remédiation hiérarchisé. Il est recommandé de programmer un retest pour valider les correctifs.
Enfin, intégrez ces tests dans une démarche continue. Faire des audits de sécurité à chaque évolution majeure, et maintenir une surveillance régulière, permet de rester en phase avec l’évolution des menaces.
Un point de passage essentiel dans une démarche de cybersécurité structurée
Le pentest web n’est pas le premier réflexe à avoir en matière de cybersécurité, mais c’est un point de passage essentiel dès que votre entreprise commence à structurer sa démarche. Une fois les mesures de base en place (mises à jour régulières, sauvegardes, gestion des accès) et une première cartographie des actifs numériques établie, tester la robustesse de vos applications devient une étape logique.
En simulant une attaque dans un cadre maîtrisé, le pentest permet de valider concrètement les protections mises en place et d’identifier les failles invisibles en surface. Il offre une vision réaliste des risques, bien plus parlante qu’un tableau de conformité. Et surtout, il transforme la cybersécurité en outil de pilotage, en vous donnant des priorités claires.
Pour une PME, intégrer un pentest web à intervalles réguliers montre que vous passez d’une logique réactive à une logique de prévention structurée. Ce n’est pas une urgence à traiter en premier, mais un investissement à programmer à moyen terme, pour consolider ce que vous avez commencé à construire.
Faire le point sur vos applications web, planifier un test adapté, et impliquer vos prestataires : voilà une démarche pragmatique pour renforcer durablement la sécurité de votre entreprise.