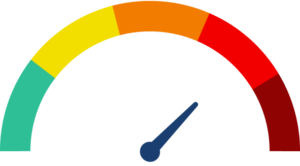Il n’est pas nécessaire d’être une grande entreprise pour se retrouver avec des dizaines de points d’accès exposés sur internet. Un site web, un outil de visioconférence, un serveur hébergé dans le cloud, une boîte mail mal protégée… En quelques mois, une organisation peut accumuler des services publics qu’elle ne maîtrise plus tout à fait. Et ce sont précisément ces zones floues qui deviennent les cibles les plus faciles pour un attaquant.
Le problème n’est pas uniquement technique. Il est surtout lié à la perte de visibilité. Dans un environnement distribué, avec des outils déployés à distance, des prestataires multiples et des collaborateurs autonomes, il devient difficile de savoir ce qui est accessible, ce qui est vulnérable ou même ce qui existe encore.

C’est là qu’intervient l’Attack Surface Management (ASM) : une démarche conçue pour cartographier en continu ce que votre entreprise expose réellement au monde extérieur. Contrairement à un audit ponctuel ou à un test d’intrusion, l’ASM adopte la perspective d’un attaquant pour identifier les failles invisibles du quotidien.
Dans cet article, vous allez découvrir ce qu’est l’ASM, à quoi cela sert concrètement, dans quels cas cette approche est pertinente, et comment elle se distingue des autres méthodes d’analyse comme l’audit de cybersécurité ou le scan de vulnérabilités.
Objectif : vous aider à décider, en connaissance de cause, si cette démarche peut s’intégrer à votre stratégie de sécurité.
1. ASM : de quoi parle-t-on concrètement ?
1.1 Une approche fondée sur la vision de l’attaquant
L’Attack Surface Management (ASM) repose sur un principe simple : observer votre système d’information comme le ferait un attaquant. Au lieu de se limiter à ce que vous pensez exposer, l’ASM identifie ce qui est réellement visible depuis l’extérieur, souvent sans que cela ait été volontairement mis en ligne ou recensé.
Cette démarche adopte une approche externe, automatisée et continue. Elle s’intéresse à tous les actifs numériques accessibles sur internet : noms de domaine, sous-domaines, adresses IP, services ouverts, certificats SSL, ports exposés, API, infrastructures cloud… L’objectif est de repérer les points d’entrée exploitables, qu’ils soient connus (et maîtrisés) ou inconnus (oubliés, mal configurés, mal désactivés).
Ce type de surveillance permet de détecter :
- des environnements de test non protégés laissés en ligne,
- des ports ouverts sur des interfaces d’administration,
- des services tiers mal sécurisés rattachés à votre domaine principal,
- ou encore des composants obsolètes exposés à des vulnérabilités connues.
En somme, l’ASM cherche à révéler l’exposition réelle de votre organisation, telle qu’un acteur malveillant pourrait l’exploiter, en allant au-delà des périmètres que vous croyez contrôler.
1.2 Qu’est-ce que la surface d’attaque ?
La surface d’attaque désigne l’ensemble des points d’accès exploitables par un attaquant pour compromettre un système. Elle comprend tous les services, applications, ports, équipements ou interfaces accessibles publiquement, intentionnellement ou non.
Quelques exemples typiques de surface d’attaque mal maîtrisée :
- un sous-domaine oublié pointant vers un serveur sans protection,
- un site web en HTTPS utilisant un certificat expiré,
- une API documentée en ligne mais sans authentification,
- un système d’impression exposé sur internet,
- un service cloud déployé sans restriction IP.
Ce périmètre est en constante évolution. Chaque ajout de service, chaque sous-traitant, chaque employé qui installe un outil ou ouvre un accès peut élargir la surface d’attaque sans que personne ne s’en rende compte.
1.3 L’ASM dans le cycle de cybersécurité
Il est essentiel de replacer l’ASM dans un ensemble plus large. L’ASM n’est pas une solution globale, ni une méthode d’évaluation à elle seule. C’est une brique complémentaire au sein d’une stratégie de cybersécurité plus large.
Voici ce que l’ASM ne fait pas :
- il ne teste pas activement les failles (ce que fait un pentest),
- il n’analyse pas les politiques internes, ni les usages métier (rôle d’un audit cybersécurité),
- il ne donne pas d’indication directe sur la gravité d’une faille, ni de recommandation précise sur la remédiation (fonction d’un scan de vulnérabilités).
En revanche, il permet de révéler ce que d’autres méthodes ne voient pas : les actifs oubliés, les expositions accidentelles, les changements non documentés.
L’ASM ne remplace donc pas un audit, un pentest ou une analyse de vulnérabilités, mais il peut les alimenter ou les compléter en amont, en apportant une vision actualisée, indépendante et exhaustive de l’exposition externe.

2. Quand et pour qui l’ASM est-il pertinent ?
L’Attack Surface Management n’est pas adapté à toutes les entreprises, ni à toutes les situations. Il s’agit d’un outil de cartographie continue, conçu pour répondre à des besoins spécifiques : perte de visibilité, complexité organisationnelle, obligations réglementaires, ou encore logique de services distribués. Dans certains contextes, il devient un complément précieux aux démarches classiques de cybersécurité.
2.1 Profils d’entreprises concernées
Toutes les entreprises n’ont pas besoin de mettre en place un programme d’ASM. En revanche, certaines structures gagnent clairement à s’y intéresser, notamment lorsqu’elles gèrent un environnement complexe, en évolution permanente, ou difficile à cadrer depuis l’interne.
Parmi les profils concernés, on retrouve notamment :
- Les grandes entreprises ou groupes multisites, dont la surface numérique est étendue et parfois mal recensée. Plus le périmètre est large, plus il est probable que des services soient exposés à l’insu des équipes responsables.
- Les infogéreurs et prestataires IT, qui gèrent des environnements clients en marque blanche, souvent sous plusieurs noms de domaine, avec des configurations différentes selon les cas. L’ASM leur permet de détecter rapidement ce qui est visible depuis l’extérieur, client par client.
- Les éditeurs SaaS (Software as a Service) et plateformes techniques, notamment ceux qui déploient des environnements dédiés pour leurs utilisateurs (en B2B, secteur public, santé ou éducation par exemple). Chaque instance peut générer des expositions spécifiques, souvent difficiles à centraliser.
- Les entreprises avec un parc de domaines publics important, ou des filiales disposant d’une certaine autonomie technique. Dans ce cas, des sites, sous-domaines ou API peuvent exister sans coordination avec les équipes sécurité du groupe.
Dans tous ces cas, le risque principal n’est pas seulement l’attaque, mais l’ignorance de ce qui est attaquable. L’ASM ne protège pas, mais il révèle les angles morts.
2.2 Cas d’usage concrets
L’ASM prend tout son sens lorsque la surveillance traditionnelle (audits internes, scans ponctuels, supervision réseau) ne suffit plus à garantir une vision claire et à jour de l’exposition numérique. Voici quelques cas typiques où il apporte une réelle valeur :
- Identifier des actifs inconnus : un ancien environnement de test laissé en ligne, une interface d’administration oubliée, un sous-domaine pointant encore vers un serveur désactivé. L’ASM détecte ce que les outils internes n’ont pas recensé.
- Suivre l’évolution de la surface d’attaque dans le temps : en mode projet, en cas de rachat, de fusion ou simplement d’évolution rapide du système d’information, il devient difficile de maintenir une cartographie fiable. L’ASM permet de détecter les changements en continu.
- Appuyer une stratégie de conformité : dans le cadre de NIS2, DORA ou d’une politique Zero Trust, il est souvent nécessaire de prouver que l’exposition est maîtrisée. Un programme ASM fournit des données exploitables pour justifier une démarche de sécurisation proactive.
- Renforcer un SOC ou une équipe cybersécurité : en apportant un flux continu d’informations sur les actifs exposés, l’ASM complète la vision fournie par les outils de détection d’intrusion ou de gestion des vulnérabilités internes.
Ces cas d’usage ne concernent pas uniquement les grandes structures. Certaines PME opérant dans des secteurs critiques (santé, finance, énergie) ou en forte croissance peuvent aussi être concernées, surtout lorsqu’elles délèguent une partie de leur infrastructure à des tiers.
2.3 Exemple de démarche partielle avec un outil d’audit
Mettre en œuvre un programme ASM complet représente un investissement. Mais il est possible de commencer plus simplement, notamment par des outils d’analyse ponctuelle.
Certaines plateformes proposent de cartographier automatiquement la surface d’exposition d’une organisation à partir d’un nom de domaine. Cela permet, en quelques minutes, de détecter :
- les services actifs visibles sur internet,
- les sous-domaines non référencés,
- les technologies utilisées (et parfois obsolètes),
- les éventuelles anomalies visibles publiquement (certificats expirés, ports ouverts…).
Ces audits ne remplacent pas une solution ASM, mais ils permettent de poser un premier diagnostic utile. C’est le cas par exemple de solutions comme Sekost, qui propose des diagnostics cyber automatisés, exploitables par des experts comme par des infogéreurs. Dans ce cadre, l’audit peut servir :
- de point d’entrée avant d’engager une démarche ASM complète,
- ou de vérification intermédiaire entre deux campagnes d’audit plus larges.
Cette approche hybride est souvent plus réaliste pour les entreprises qui n’ont pas encore structuré leur gouvernance cyber ou qui n’ont pas les ressources pour un monitoring en continu. Elle leur permet toutefois de reprendre la main sur ce qui est visible en ligne, avant même de mettre en œuvre des outils plus avancés.
3. Mettre en place une démarche ASM sans se tromper
Mettre en œuvre une démarche d’Attack Surface Management peut apporter une réelle valeur… à condition d’être bien préparé. L’ASM n’est pas un outil magique : il repose sur une méthode structurée, des ressources mobilisables et une capacité à traiter les informations qui en découlent. Voici les points à respecter pour éviter les erreurs les plus fréquentes.

3.1 Étapes clés à respecter
1. Définir un périmètre de départ.
Il n’est pas nécessaire de tout surveiller immédiatement. Commencer par les actifs critiques exposés à internet (domaines publics, applications client, services d’administration) permet de concentrer les efforts sur ce qui présente le plus de risques. Il est aussi pertinent de prioriser certains environnements (production, cloud, services clients…) ou certaines entités (filiales, marques, partenaires).
2. Lancer la découverte automatisée.
Une fois le périmètre défini, il s’agit de cartographier les actifs effectivement exposés. Cette étape peut être réalisée à l’aide de plateformes spécialisées ou opérée par un prestataire disposant des bons outils. L’objectif est de détecter automatiquement les noms de domaine, sous-domaines, services actifs, ports ouverts, certificats, interfaces accessibles…
3. Organiser la revue des actifs et la mise à jour continue.
L’intérêt de l’ASM réside dans sa régularité. Il faut donc prévoir des cycles de revue périodique, avec des processus clairs pour qualifier les découvertes (est-ce légitime, utile, à supprimer ?). Sans cela, les résultats s’accumulent sans action, et l’outil perd en valeur. L’idéal est de connecter les données ASM à un référentiel d’actifs ou à un processus de gestion de la sécurité existant.
3.2 Ce qu’il faut éviter
L’une des erreurs les plus fréquentes consiste à croire que l’ASM protège activement contre les attaques. Ce n’est pas le cas. Il s’agit d’un outil de visibilité, pas d’un dispositif de défense. Il n’empêche ni les intrusions ni les fuites de données : il permet seulement de voir ce qui pourrait être exploité. Penser le contraire conduit à une fausse impression de sécurité, souvent dangereuse.
Autre piège classique : s’en remettre entièrement à la technique. Même les outils les plus avancés nécessitent un minimum de cadrage humain. L’ASM remonte des informations brutes qui doivent être analysées, triées, contextualisées. Sans validation, vous risquez de traiter des données inexploitables ou, pire, de passer à côté de signaux importants.
Il faut également éviter de lancer une démarche ASM sans avoir les moyens de traiter les résultats. Identifier un actif oublié ou une configuration à risque est inutile si personne n’est en mesure d’agir. Il est donc essentiel de s’assurer que les équipes concernées (IT, sécurité, prestataires) sont mobilisables pour gérer les correctifs nécessaires.
Enfin, négliger l’intégration de l’ASM dans les processus existants est une source de blocage. Un outil qui fonctionne en silo, sans lien avec la gouvernance cyber, la gestion des incidents ou les audits réguliers, perd rapidement en efficacité. Pour que l’ASM soit utile, il doit être connecté à la réalité opérationnelle de l’entreprise.
3.3 Intégrer l’ASM à une stratégie plus large
L’ASM n’est pas une solution isolée, mais une brique de surveillance dans une gouvernance cybersécurité structurée. Il peut venir :
- en soutien à un audit régulier (pour compléter les analyses internes),
- en amont d’une analyse de vulnérabilités (pour savoir ce qu’il faut scanner),
- ou en réponse à des obligations réglementaires (cartographie des expositions demandée dans le cadre de NIS2 ou DORA).
Dans cette logique, un diagnostic rapide d’exposition, comme celui que peut proposer Sekost, peut représenter une première étape utile. À partir d’un simple nom de domaine, il est possible d’ identifier les principaux points d’exposition, de visualiser la surface publique d’une organisation, et de prendre les premières décisions (remédiation, cloisonnement, désactivation).
Ce type d’audit est particulièrement pertinent :
- en début de démarche, pour établir une base de référence,
- en complément d’un audit plus large, pour vérifier la cohérence entre ce qui est exposé et ce qui est attendu,
- ou en point de contrôle ponctuel, entre deux campagnes de sécurité.
L’important est de garder une logique progressive, actionnable, et connectée à vos capacités internes. L’ASM est un outil d’éclairage. Il devient stratégique à partir du moment où vous pouvez en tirer des décisions concrètes.
Conclusion
Si vous vous demandez si l’ASM est une solution pour votre entreprise, posez-vous une seule question : savez-vous précisément ce que votre organisation expose aujourd’hui sur internet ? Si la réponse est non, alors l’ASM peut vous apporter une valeur immédiate.
Ce n’est pas un outil de protection, ni un nouveau gadget technique. C’est un moyen de reprendre la main sur ce qui est visible de l’extérieur, là où les outils internes ou les audits classiques ne suffisent plus.
L’ASM n’est pas indispensable pour tous. Mais si vous gérez plusieurs domaines, des services distribués, des prestataires techniques ou une infrastructure cloud en expansion, vous gagnerez à avoir cette visibilité.
Et si vous n’êtes pas prêt à vous lancer dans une démarche continue, un audit de surface ponctuel peut suffire à révéler des angles morts critiques. Ce type de diagnostic est simple à mettre en œuvre, mais peut changer profondément la façon dont vous priorisez votre sécurité.