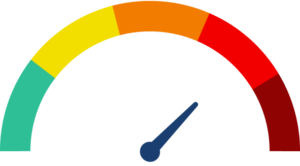Aujourd’hui, aucune entreprise n’est à l’abri d’une cyberattaque. Que vous dirigiez une PME industrielle, un cabinet d’expertise comptable ou une société de services, votre système d’information expose, sans que vous en ayez toujours conscience, des failles que des attaquants peuvent exploiter. Mots de passe faibles, logiciels non à jour, services accessibles sur internet sans protection : ce sont souvent ces petites vulnérabilités, invisibles au quotidien, qui provoquent les incidents les plus critiques.

Dans ce contexte, l’analyse de vulnérabilité est devenue un réflexe incontournable. Elle permet de savoir, de façon concrète et structurée, où se trouvent vos points faibles, quels sont les risques associés, et quelles actions mettre en œuvre en priorité. C’est une démarche préventive, rapide à mettre en place, et qui ne demande pas nécessairement de compétences techniques en interne.
Mieux encore : pour les dirigeants non spécialistes, l’analyse de vulnérabilité est souvent le premier levier utile pour reprendre le contrôle sur la cybersécurité de l’entreprise. Elle donne de la visibilité, de la méthode, et permet de ne plus agir dans le flou ou sous la pression d’une urgence.
Dans cet article, vous allez découvrir :
- Ce qu’est une analyse de vulnérabilité, et en quoi elle diffère d’un test d’intrusion,
- Quelle est la méthode utilisée pour identifier les failles,
- Comment vous pouvez la mettre en œuvre concrètement, même sans équipe IT,
- À quoi ressemble un exemple d’évaluation dans la vraie vie,
- Et enfin, quel est le rôle d’un analyste dans ce processus.
Objectif : vous aider à y voir clair, à poser un premier diagnostic, et à concentrer vos efforts là où cela compte vraiment.
1. Comprendre ce qu’est une analyse de vulnérabilité
Une définition simple et concrète
Une vulnérabilité est une faiblesse dans un système informatique, qui peut être exploitée par un attaquant pour compromettre la confidentialité, l’intégrité ou la disponibilité des données ou des services. Il peut s’agir d’un défaut de conception, d’une erreur de configuration, d’un composant logiciel non mis à jour, ou même d’une mauvaise pratique humaine.
L’analyse de vulnérabilité est un processus qui consiste à détecter automatiquement ces failles, avant qu’elles ne soient exploitées. Elle repose sur des outils appelés scanners de vulnérabilités, capables d’examiner des serveurs, sites web, applications, bases de données, ou encore services exposés sur internet.
Son objectif est simple : prévenir les attaques en identifiant ce qui est exposé, ce qui est obsolète, mal protégé ou mal configuré. Contrairement à un test d’intrusion, une analyse de vulnérabilité n’exploite pas les failles, elle se contente de les détecter, de les classifier, et de recommander des actions.
Pour une entreprise, c’est un outil de prévention rapide, structurant et peu intrusif, qui peut s’intégrer à un audit ponctuel ou à une stratégie de sécurité continue.
Prévenir, hiérarchiser, corriger
L’analyse de vulnérabilité est souvent le premier maillon d’une chaîne de sécurité efficace. Elle permet de :
- Prévenir les incidents en détectant les failles avant qu’elles ne soient exploitées
- Prioriser les actions à mener en fonction du niveau de risque (toutes les vulnérabilités ne se valent pas)
- Corriger rapidement les faiblesses critiques grâce à des recommandations concrètes
C’est un excellent outil pour reprendre le contrôle sur ce que l’entreprise expose réellement, même en l’absence de compétences techniques internes. Pour une PME, c’est souvent la première étape vers une sécurité plus structurée, sans complexité.
Les trois critères d’évaluation d’une vulnérabilité
Une vulnérabilité détectée n’est pas toujours critique. Pour mieux en évaluer la gravité, on utilise généralement trois critères clés :
- Facilité d’exploitation : Est-ce qu’un attaquant pourrait facilement exploiter la faille ? Par exemple, une faille accessible sans authentification est plus critique qu’une vulnérabilité nécessitant un accès complexe.
- Impact potentiel : Que se passe-t-il si la faille est exploitée ? Perte de données ? Arrêt de service ? Accès à des informations sensibles ?
- Niveau réel d’exposition : La vulnérabilité est-elle visible depuis internet ? Est-elle activement exploitée dans des attaques en cours ?
Ces critères sont intégrés dans des systèmes de notation comme le CVSS (Common Vulnerability Scoring System). Le score, sur 10, aide à prioriser les actions selon un standard reconnu mondialement.
Les grandes familles de vulnérabilités
Les vulnérabilités identifiées par une analyse peuvent appartenir à différentes catégories :
- Vulnérabilités logicielles : erreurs de code, versions obsolètes, composants non mis à jour
- Failles de configuration : redirections de ports oubliées, services mal sécurisés, protocoles faibles
- Problèmes d’accès : mots de passe par défaut, absence de double authentification, droits excessifs
- Expositions involontaires : fichiers accessibles publiquement, interfaces mal cloisonnées
- Failles humaines : absence de sensibilisation, erreurs de manipulation, défauts de supervision
Un test bien mené permet de couvrir l’ensemble ou une partie de ces familles, en fonction du périmètre défini et de la méthode employée (externe, interne, authentifiée…).
5 vulnérabilités fréquentes dans les petites entreprises
Voici quelques exemples très courants, souvent rencontrés lors d’un premier test :
- Un site WordPress dont les extensions ne sont plus maintenues
- Un mot de passe par défaut sur des comptes d’administration
- Un serveur ou une imprimante exposé sur internet sans protection
- Une boîte mail sans authentification à deux facteurs
- Un accès admin à distance laissé ouvert sans filtrage IP
Ces failles peuvent paraître mineures, mais elles sont les plus souvent exploitées par les cybercriminels. L’avantage, c’est qu’elles peuvent être détectées facilement, parfois dès un premier scan à partir d’un simple nom de domaine. Certaines plateformes, comme Sekost, proposent ce type de test à distance, sans installation, avec un rapport compréhensible même pour un non-technicien.
Analyse de vulnérabilité ou pentest : deux approches complémentaires
Il est fréquent de confondre analyse de vulnérabilité et test de pénétration (ou pentest). Pourtant, ces deux démarches répondent à des objectifs différents :
- L’analyse de vulnérabilité est automatisée, rapide et préventive. Elle identifie les failles connues, mais ne tente pas de les exploiter.
- Le pentest est manuel, ciblé et offensif. Il simule une attaque réelle pour évaluer jusqu’où un attaquant pourrait aller.
Autrement dit, l’analyse vous dit ce qui est fragile, le pentest vous montre ce qui peut être cassé.
Dans la plupart des cas, notamment en PME, l’analyse de vulnérabilité est une première étape logique et suffisante pour engager une stratégie de cybersécurité efficace, avant d’envisager des audits plus complets.
2. Quelle est la méthode utilisée ?
L’analyse de vulnérabilité suit une méthode structurée, conçue pour fournir une vision claire et exploitable de l’état de sécurité d’un système. Elle repose sur quatre grandes étapes, qui peuvent être menées en interne, par un prestataire ou via des plateformes spécialisées.
Étape 1 : Identifier le périmètre et les actifs à analyser
Avant tout, il faut définir ce que l’on veut analyser. Cela peut être un site internet, un serveur, un réseau interne, une application métier, ou l’ensemble du système d’information. Dans les petites entreprises, cette étape consiste souvent à dresser un inventaire des services utilisés, en interne comme en ligne (emails, hébergements, outils collaboratifs…).
Cette phase inclut également la détermination des objectifs : recherche de conformité, réduction du risque, préparation d’un audit ou d’une certification, etc.
Étape 2 : Scanner les ressources
Une fois le périmètre défini, l’analyse proprement dite commence par un scan automatisé. Le scanner de vulnérabilité passe en revue les éléments ciblés à la recherche de failles connues : logiciels obsolètes, ports ouverts, configurations non sécurisées, etc. Le scan peut être lancé à partir d’un nom de domaine, d’une adresse IP ou d’un accès aux systèmes internes selon le type d’analyse.
Étape 3 : Analyser et hiérarchiser les résultats
Les vulnérabilités détectées sont ensuite classées par niveau de criticité. Cette hiérarchisation est essentielle pour savoir par quoi commencer. Certaines failles peuvent être immédiatement exploitables, tandis que d’autres représentent un risque faible ou très théorique. L’outil (ou l’analyste) attribue généralement un score de risque à chaque vulnérabilité, accompagné d’une explication.

Étape 4 : Recommander des actions correctives
Enfin, un rapport est généré avec des recommandations précises : mise à jour, changement de mot de passe, désactivation d’un service, configuration à ajuster… L’objectif est de fournir un plan d’action lisible, que l’entreprise pourra mettre en œuvre en interne ou avec l’aide de son prestataire IT.
Certaines solutions, comme le Diagnostic Sekost, proposent même une priorisation automatique des actions à réaliser, en tenant compte du contexte (type de données, exposition sur internet, facilité d’exploitation…).
Types d’analyse : interne, externe, authentifiée ou non
Selon l’objectif de l’analyse, plusieurs approches peuvent être utilisées :
- Analyse externe : observe ce qu’un attaquant pourrait voir depuis l’extérieur (site web, messagerie, accès à distance)
- Analyse interne : explore les vulnérabilités présentes à l’intérieur du réseau (postes de travail, serveurs locaux)
- Analyse authentifiée : réalisée avec des identifiants utilisateurs pour tester les failles accessibles après connexion
- Analyse non authentifiée : simule un attaquant sans accès préalable au système
Pour une PME, une analyse externe non authentifiée est souvent un bon point de départ : elle permet de détecter rapidement les failles les plus exposées sans perturber l’activité.
Outils disponibles selon les besoins
Il existe de nombreux outils sur le marché :
- Scanners open source comme OpenVAS ou Nmap, utiles mais nécessitant des compétences techniques
- Solutions professionnelles comme Nessus, Qualys ou Rapid7, utilisées par les experts
- Plateformes automatisées à distance, accessibles sans installation ni configuration, conçues pour des entreprises sans équipe dédiée. Ces outils analysent l’exposition depuis internet et livrent un rapport lisible, souvent accompagné d’un plan d’action.
Type d’analyse vs. situation d’entreprise
| Situation de l’entreprise | Type d’analyse recommandé | Objectif principal |
| PME sans équipe IT | Externe, non authentifiée | Identifier les failles visibles sur internet |
| PME avec prestataire informatique | Externe + authentifiée | Vérifier les services exposés + utilisateurs |
| Entreprise avec réseau interne complexe | Interne, externe, authentifiée | Détecter les failles internes et privilèges |
| En vue d’une certification (ISO, RGPD, etc.) | Mixte (interne + externe) | Préparer la conformité |
L’important est d’adapter la méthode à la taille de l’entreprise, à son niveau de maturité, et à ses priorités du moment. Une première analyse même simple peut révéler des points critiques ignorés et constitue déjà une avancée majeure.
3. Comment lancer et exploiter un test de vulnérabilité quand on n’est pas expert ?
3.1 Qui peut réaliser le test : les options selon votre contexte
Faire une analyse de vulnérabilité ne nécessite pas forcément une équipe de cybersécurité ou un DSI. Il existe plusieurs manières de procéder, selon la taille de votre entreprise, vos ressources internes et votre niveau de maturité.
- En interne, si vous disposez d’un service informatique formé aux outils de sécurité. C’est rare dans les PME, mais envisageable dans les structures plus matures.
- Via un prestataire ou votre infogéreur, qui peut piloter l’analyse avec des outils professionnels et vous accompagner sur l’interprétation des résultats.
- À l’aide d’une plateforme automatisée, qui vous permet de réaliser un test à distance, sans intervention technique. Ce type de service convient parfaitement aux petites structures : il suffit généralement d’indiquer un nom de domaine ou une adresse IP pour lancer l’analyse.
Dans tous les cas, l’essentiel est de recevoir un rapport clair, lisible et exploitable. Un bon test ne se contente pas de détecter des failles : il vous aide à les comprendre et à décider quoi faire ensuite.
3.2 Ce qu’il faut préparer avant de se lancer
Avant de lancer le test, prenez un moment pour cadrer les choses :
- Quel est le périmètre à analyser ? Est-ce uniquement votre site web, votre messagerie, vos serveurs internes, vos outils collaboratifs ?
- Quels sont les objectifs ? Vous cherchez à faire un état des lieux ? Préparer un audit ? Répondre à une exigence client ou réglementaire ?
- Qui sera le point de contact ? Il est utile de désigner une personne référente, même sans expertise technique, pour recevoir les résultats et coordonner les suites.
Définir vos objectifs permet de choisir le mode d’analyse le plus adapté à vos besoins. Cette préparation ne prend que quelques heures, mais elle fait toute la différence dans la qualité de l’analyse.
3.3 Exemple concret : une entreprise de 50 personnes face à son premier audit

Prenons le cas d’une PME de 50 salariés, qui gère son activité via un site web WordPress, utilise des services cloud pour la gestion de projet et a recours à un prestataire informatique pour l’infrastructure.
La direction décide de faire un point sur sa cybersécurité. Elle opte pour un test automatisé à distance, via une plateforme spécialisée. Elle fournit simplement son nom de domaine et sélectionne les services à analyser.
Quelques jours plus tard, le rapport tombe :
- Le site web utilise un plugin non mis à jour depuis 18 mois, contenant une faille critique connue.
- Un port d’accès distant (RDP) est accessible depuis internet, sans filtrage ni double authentification.
- Des mots de passe identiques sont utilisés sur plusieurs comptes administrateurs.
Ce rapport, même sans langage technique complexe, permet à la direction de prendre des décisions rapides :
- Le prestataire met à jour le site et change les plugins.
- L’accès RDP est limité aux utilisateurs connectés au VPN.
- Un gestionnaire de mots de passe est mis en place pour toute l’équipe.
Les 3 leviers activés après ce premier audit :
- Visibilité : l’entreprise découvre des expositions critiques dont elle n’avait pas conscience.
- Priorisation : elle identifie les actions urgentes, sans perdre de temps sur des détails secondaires.
- Responsabilisation : elle prend des mesures concrètes et engage son prestataire dans une démarche proactive.
3.4 Le rôle de l’analyste : rendre les résultats compréhensibles et actionnables
Dans certaines situations, notamment quand le rapport contient des résultats complexes ou quand des décisions stratégiques sont en jeu (investissements, obligations légales), il peut être utile de faire appel à un analyste en cybersécurité.
Son rôle n’est pas simplement technique. Il agit comme un traducteur de risque :
- Il aide à comprendre ce que chaque faille implique pour l’entreprise.
- Il explique les priorités, les niveaux de criticité, et les liens avec vos obligations réglementaires ou contractuelles.
- Il peut également accompagner la mise en œuvre du plan d’action.
Dans d’autres cas, notamment pour les premiers tests ou les audits de surface, un bon outil d’analyse peut déjà remplir ce rôle. Certaines plateformes comme Sekost, par exemple, proposent des rapports clairs, triés par priorité, avec des recommandations compréhensibles même pour un dirigeant non technique.
L’essentiel est de ne pas rester seul face à un listing de failles brutes. Ce qui compte, c’est d’avoir un document qui vous permettra d’agir, de suivre, et de progresser dans une logique claire.
Conclusion
L’analyse de vulnérabilité n’est pas un luxe réservé aux grandes entreprises ou aux experts en cybersécurité. C’est au contraire l’un des moyens les plus accessibles, concrets et efficaces pour reprendre la main sur la sécurité de votre système d’information.
En tant que dirigeant, vous n’avez pas besoin d’être technicien pour comprendre où se situent vos failles ni pour agir là où cela compte. Une analyse bien menée vous apporte trois bénéfices immédiats : une vision claire de votre exposition, une priorisation des actions utiles, et une capacité à décider en connaissance de cause, sans subir l’incertitude.
Des solutions existent aujourd’hui pour vous accompagner à chaque étape, que ce soit à travers un prestataire, une équipe interne ou une plateforme automatisée. L’important, c’est de faire ce premier pas. Même un test simple peut révéler des points critiques, faciles à corriger mais invisibles au quotidien.
Agir maintenant, c’est éviter des crises demain. Mieux vaut une analyse de vulnérabilité anticipée qu’une attaque subie dans l’urgence. Et comme souvent en cybersécurité, les actions les plus simples sont souvent les plus efficaces… à condition de les engager à temps.